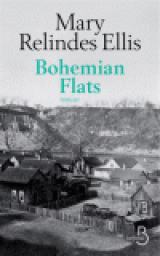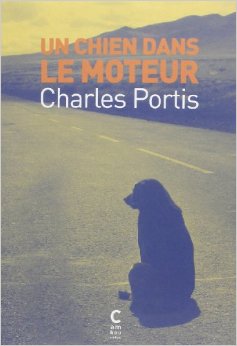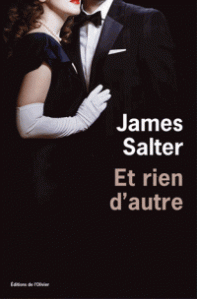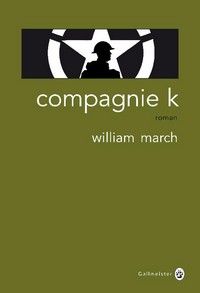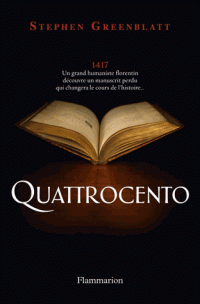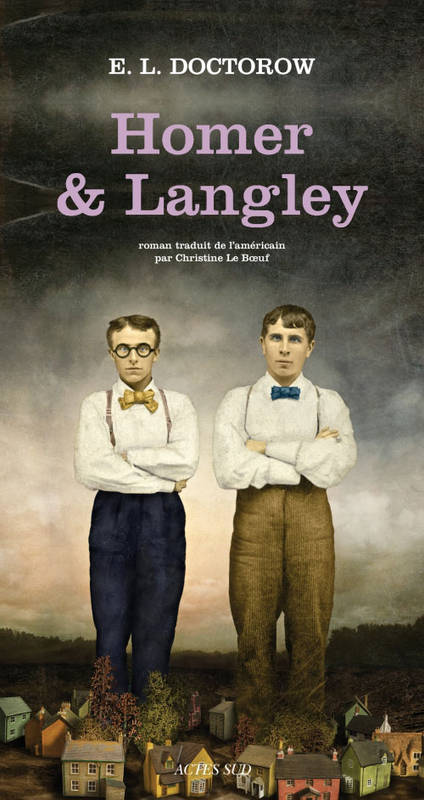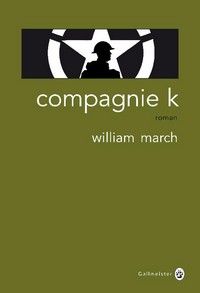
«Le bruit des hommes qui rient, hurlent, jouent ou prient…le bruit même de la guerre.»
La compagnie K de l’US Marines Corps débarque en France en décembre 1917.
William March (1893-1954) raconte la Grande Guerre telle que l’ont vécue les soldats américains.
«Compagnie K» publié en 1933 est son premier roman.
Les très belles, très recommandables, voire indispensables éditions Gallmeister nous offre, dans sa collection Americana, pour la première fois en français, la traduction de ce roman saisissant.
Cher lecteur avide de commémoration, si vous ne savez pas quoi lire pour le centenaire de la guerre de 14-18, vous pouvez déjà réserver ce livre inoubliable.
A empiler sur «Le feu» d’Henri Barbusse, «La main coupée» de Blaise Cendrars, «14« de Jean Echenoz et «Au revoir là-haut» de Pierre Lemaitre.
La littérature ne démontre pas, elle montre.
Essentielle et vitale littérature !
«Au début, ce livre devait rapporter l’histoire de ma compagnie, mais ce n’est plus ce que je veux maintenant. Je veux que ce soit une histoire de toutes les compagnies, de toutes les armées. Si ses personnages et sa couleur sont américains, c’est uniquement parce que c’est le théâtre américain que je connais. Avec des noms différents et des décors différents, les hommes que j’ai évoqués pourraient tout aussi bien être français, allemands, anglais, ou russes d’ailleurs.»
Ce livre pourrait être LE livre de toutes les guerres : Vietnam, deuxième guerre mondiale, celles d’hier, d’aujourd’hui…de demain !
Et c’est là la grande force de ce roman de William March.
De l’embarquement pour la France au retour au pays, en passant par les tranchées de la mort, March nous crie à la figure, de mille et vives voix, la guerre.
Soldat, sergent, caporal ou lieutenant, venus des lacs de l’Alabama ou de la campagne de Virginie, ces hommes vont mourir et survivre, rire et pleurer, trembler et tuer devant nos yeux.
Des lâches et des courageux, des intrépides et des peureux, des déserteurs et des mutins…des hommes quoi.
Après deux semaines de traversée entassés dans un navire voilà nos «boys» américains débarqués sur notre sol prêts à en découdre contre des «teutons» aussi inconnus que le pays où ils viennent combattre.
Bienvenue dans les tranchées : vermine, rats, froid, boue, faim…et fin pour beaucoup !
Puis les assauts, les «nids» de mitrailleuses, les pluies d’obus et les combats au corps à corps à la baïonnette.
Terrible !
Comme la rencontre avec cet allemand blessé, agonisant, qui fouille dans sa veste pour sortir de sa poche…la photographie de sa fille.
«Le barbu a levé la main pour fouiller à l’intérieur de sa veste. J’ai cru qu’il allait nous jeter une grenade et je lui ai vidé mon pistolet dans le corps.»
Insupportable !
Comme ce soldat américian qui refuse de partir à l’assaut et qui sera froidement exécuté d’une balle par son supérieur.
«-Sors de là ! il a crié encore.
-Je vais pas plus loin, j’ai dit. J’en peux plus.»
Révoltant !
Comme ce courrier adressé aux parents d’hommes tombés au combat.
«…il avait compris que toutes ces choses auxquelles vous, sa mère, lui aviez appris à croire sous les mots d’honneur, courage et patriotisme, n’étaient que des mensonges…»
Hilarant !
Comme cette scène où tout un bataillon de soldats américains se retrouvent nus comme des vers dans un champ près de Belleville pendant que leurs vêtements cuisent dans une étuve.
C’est l’épouillage.
«Au bout d’un moment, le champ s’est retrouvé entouré de spectateurs, surtout des femmes, qui s’étaient assises dans l’herbe pour regarder…»
Emouvant !
Comme ce soldat américain qui clame : «J’apprendrai à lire ! Quand la guerre sera finie, j’apprendrai à lire !…»
Horrifiant !
Comme ces descriptions de blessures.
«Sa mâchoire avait été en partie emportée et elle pendait, mais quand il nous a vus il a tenu l’os décroché dans sa main et il a émis un son qui exprimait la peur et la soumission.»
Désespérant !
Comme ce jeune soldat qui vient de tuer un homme pour la première fois et qui pleure : «Je ne ferai plus jamais de mal jusqu’à la fin de ma vie…Plus jamais…Plus jamais !…»
Démoralisant !
Comme le retour au pays avec une gueule cassée, défigurée. Les retrouvailles avec celle qu’on aimait, avec elle qui vous aimait.
Celle qui vous retrouve et vous regarde et dit : »Si tu me touches, je vomis.»
La compagnie K a combattu dans l’Aisne, la Marne, la Meuse, à Verdun.
Rendons leur hommage en lisant ce livre remarquable de lucidité.
Dénonçons la guerre, toutes les guerres et ses planqués de généraux qui jouent aux petits soldats dans des salons onctueux de honte en lisant ce livre remarquable d’humanité.
Un chef-d-oeuvre ?
Peut-être…à vous de lire…à vous de le dire…
«La seule chose qu’on sait, c’est que la vie est douce et qu’elle ne dure pas longtemps.», dernières paroles du soldat Manuel Burt.